Gérer des grands programmes, c’est d’abord gérer des risques. Risques bien connus sur le besoin, sur les coûts, les délais, la performance, risques de défaillance fournisseur, risques techniques, d’approvisionnement, contractuels, juridiques, et j’en passe.
Alors quand nos chefs nous demandent de prendre des risques, la réponse semble évidente : on sait gérer !
Et pourtant, prendre un risque, c’est s’exposer à se tromper, et donc avoir un « droit à l’erreur ». Est-ce bien cela ?
C’est aussi s’exposer à échouer, et pouvoir se faire reprocher un gaspillage inutile, avoir un « droit à l’échec ». Toujours d’accord ?
Dans les faits, l’injonction de prendre des risques n’implique pas de façon naturelle l’acceptation de l’erreur ou de l’échec. Car pour beaucoup, la prise de risques doit être contrôlée, elle doit s’appuyer sur une démarche analytique visant à identifier des événements redoutés, les quantifier en probabilité et en gravité, et mettre en œuvre des moyens de réduction soit d’occurrence, soit d’impact. Pour confortable qu’elle soit, cette démarche pseudo-rationnelle cache de dangereux présupposés : d’abord que les événements redoutés soient quantifiables, ce qui est déjà beaucoup. Mais aussi qu’on puisse les identifier tout simplement… Et lorsqu’on doit inventer, résoudre des problèmes nouveaux, entreprendre, ce n’est pas le cas. On parle alors d’incertitude plus que de risque.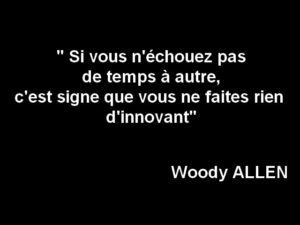
Réciproquement, se donner le droit à l’erreur ou à l’échec n’implique pas le goût de prendre des risques : les études sur l’entrepreneuriat ont ainsi constaté que les entrepreneurs n’aiment pas le risque, mais raisonnent en « perte acceptable ». Quelle perte serais-je prêt à consentir et assumer sur mes projets ? Quelle perte serais-je prêt à couvrir pour mes équipes ?
Finalement, pour traiter l’incertitude, il faut une autre démarche : avancer et construire simultanément. Cela implique une exigence majeure : se faire confiance à soi-même et à ses capacités de réussite, faire confiance à son environnement ! En sommes-nous capables ?